Le journal Fakir est un journal papier, en vente dans tous les bons kiosques près de chez vous.
Il ne peut réaliser des reportagesque parce qu’il est acheté
ou parce qu’on y est abonné !
Mille « plans sociaux » ont jalonné l’été.
Parmi eux, un m’a marqué : l’affaire Doux.
Aussitôt, j’ai songé : voilà une caricature de l’époque. Qui cette entreprise rendait-elle heureux ? Les ouvriers ? Les poulets ? Les aviculteurs ? Les paysans du Sud ? Elle fabriquait plutôt, me semblait-il, du malheur en série. Sa faillite, c’était l’occasion de tout changer. Et pourtant, syndicats, médias, ministres ne nourrissaient qu’un seul espoir : un plan de continuation, que tout reprenne comme avant. Les dissidents, altermondialistes, anti-productivistes, gauchistes divers, en guise de lutte, ont publié des communiqués sur Internet. Le système s’est donc remis sur pied, à l’identique – avec sans doute quelques milliers d’emplois en moins.
La même histoire qui se répétait. À l’automne 2008, le système financier s’est cassé la figure. Les banquiers eux-mêmes, et leurs porte-voix politiques, se livraient à des autocritiques en place publique : oui, ils s’étaient gavés durant des années. Oui, ils avaient ruiné des ménages, des villes, des pays. C’était l’occasion de tout changer. Et nous avons bien manifesté, à plusieurs millions, aux cris de « Nous ne paierons pas leur crise », mais sans plan de bataille, sans dirigeants de rechange. Le système s’est donc remis sur pied, à l’identique. Et même, autour du cou des peuples, l’argent resserre encore la corde, d’un plan de rigueur à un Traité européen.
Le dossier Doux illustre ça, en raccourci.
L’absurdité d’une agriculture mondialisée, à coup sûr. Mais surtout nos propres faiblesses. Car à quoi bon dénoncer l’ennemi, pleurnicher sur ses ruses, ses coups, sa puissance ? C’est un ennemi, prêt à tout pour maintenir son taux de profit. Mieux vaut s’attaquer à nos propres défaillances. Comment se fait-il que, après la chute de Lehman Brothers, nous n’ayons pas su saisir cette chance, imposer nos réformes, faire mettre un genou à terre à la finance ? Comment se fait-il que, idem, après la chute de Doux, nous n’ayons pas su saisir cette chance, reconvertir cette filière, imposer nos réformes, en faveur de la justice sociale, du progrès environnemental, de la solidarité internationale ?
Nous n’avons même pas perdu la bataille Doux. Elle n’a pas eu lieu.
À peine des escarmouches. Et que dire des « batailles » autour des banques renflouées, du crédit privatisé, du libre-échange intouché ? Ont-elles eu lieu, vraiment ? C’est que nos idées n’étaient pas mûres, ou inadaptées au terrain, ou mal diffusées dans le pays, et que les forces sociales ont manqué pour les porter.
D’autres Doux se produiront.
La crise nous promet encore des soubresauts. Soyons prêts, cette fois, prêts à nous glisser dans la fenêtre d’opportunité que nous ouvrira l’histoire. Voire à en forcer l’ouverture...
« Mais est-ce que vous êtes heureux, ici ? » Des rires répondent. Une hilarité collective, contenue. Qui passe d’un rang à l’autre : « T’as entendu ce qu’il a demandé ? « Est-ce qu’on est heureux, ici ? »
– Il veut rigoler ! On est là pour la paye…
– C’est la chaîne. »
Le moment est mal choisi, c’est vrai, pour les questions existentielles : on piétine à l’entrée de l’usine Doux, à Graincourt, dans le Pas-de-Calais. Clopes au bec, moustaches inquiètes, sacs à main en bandoulière, ouvrières et ouvriers sont rassemblés sur le parking, par petits groupes, en ce matin de juillet. Ils débraient depuis l’aube, espèrent encore. Conservent des lambeaux de foi. Qu’il y aurait des projets de reprise, que « là-haut ils vont sortir un lapin blanc de leur chapeau ».
En visite sur le site, d’ailleurs, l’administrateur judiciaire leur a confirmé qu’ « il y aurait, éventuellement, deux acheteurs potentiels », et malgré le conditionnel, et le « éventuellement », et le « potentiels », eux veulent y croire. Malgré les déceptions passées, aussi : « Ils nous ont menti sur un Hollandais, qui devait venir, qui pouvait racheter, mais on l’a jamais vu. Comme ça, on se tient sage. On travaille bien jusqu’au bout. On remplit les commandes. » Et à eux que l’angoisse tenaille, je jette mon interrogation bourgeoise : « Mais est-ce que vous êtes heureux, ici ? » Après la surprise, les remarques fusent, en vrac, de Philippe, Sylvie, Virginie, Jean-Luc, je peine à noter les prénoms au vol, et encore davantage leurs observations sur les salaires, la sécurité, la formation, les souffrances, etc. Je vais classer ça dans l’ordre, maintenant, qu’on entrouvre la porte de ce paradis.
Les clopinettes
« On enlève la prime de froid, on est au Smic. Je ne me rappelle plus avoir eu une augmentation depuis 25 ou 30 ans. » « Avec mon mari, on a un deuxième boulot à côté : on passe tout l’été à faire du gardiennage à Paris. Ça fait cinq ans qu’on n’a pas pris de vacances. Ma fille, je ne la vois plus, je la croise. » « On a acheté une maison il y a deux ans, on en a encore pour 23 ans à la rembourser. On voulait aller au Crédit immobilier de France, mais ils ont refusé : “Nous, on ne prête pas pour les employés de chez Doux. Vous n’êtes pas payés, et le groupe n’est pas solide.” »
« Un directeur, je lui ai dit : “Toi, tu fais tes courses où ?
- À Auchan.
-Moi, à Aldi.” »
Les souffrances
« Ici, ils ne voient que le rendement. À la découpe, on tournait à 2 700 poulets à l’heure, on est passés à 3 200. Ça use. Ça fait des tendinites. Les femmes, la tête baissée, souffrent des cervicales. » « Avec mes cartons de 15 kilos, j’ai calculé : je porte deux tonnes par jour. Depuis quinze ans. Forcément, le dos morfle. » « Après 23 ans ici, ils se sont aperçus qu’on était à 90 décibels. On a perdu des dixièmes au niveau des oreilles, des yeux. » « Ils me font faire un boulot très dur, malgré ma sciatique. Mais on hésite à se mettre en arrêt-maladie, à cause des jours de carence : on est déjà à découvert. »
L’irrespect
« On tourne au ralenti. Du coup, les bêtes abattues vendredi, on ne les a découpées qu’hier, mercredi. Les escalopes avaient une drôle d’odeur. J’ai appelé le chef : “C’est ta bouche, il m’a répondu, elle est trop près de ton nez.” Alors qu’avec cette puanteur, j’étais au bord de dégueuler. »
----------
Pour lire la suite de ce dossier, qui nous emmène en Bretagne à la rencontre de techniciens agricoles, puis dans les bureaux des intellos de la volaille, et enfin sur la voie à suivre qu’est le Cameroun... c'est ici
Aussitôt, j’ai songé : voilà une caricature de l’époque. Qui cette entreprise rendait-elle heureux ? Les ouvriers ? Les poulets ? Les aviculteurs ? Les paysans du Sud ? Elle fabriquait plutôt, me semblait-il, du malheur en série. Sa faillite, c’était l’occasion de tout changer. Et pourtant, syndicats, médias, ministres ne nourrissaient qu’un seul espoir : un plan de continuation, que tout reprenne comme avant. Les dissidents, altermondialistes, anti-productivistes, gauchistes divers, en guise de lutte, ont publié des communiqués sur Internet. Le système s’est donc remis sur pied, à l’identique – avec sans doute quelques milliers d’emplois en moins.
C’était pour moi une métaphore de la crise.
Le dossier Doux illustre ça, en raccourci.
L’absurdité d’une agriculture mondialisée, à coup sûr. Mais surtout nos propres faiblesses. Car à quoi bon dénoncer l’ennemi, pleurnicher sur ses ruses, ses coups, sa puissance ? C’est un ennemi, prêt à tout pour maintenir son taux de profit. Mieux vaut s’attaquer à nos propres défaillances. Comment se fait-il que, après la chute de Lehman Brothers, nous n’ayons pas su saisir cette chance, imposer nos réformes, faire mettre un genou à terre à la finance ? Comment se fait-il que, idem, après la chute de Doux, nous n’ayons pas su saisir cette chance, reconvertir cette filière, imposer nos réformes, en faveur de la justice sociale, du progrès environnemental, de la solidarité internationale ?
Nous n’avons même pas perdu la bataille Doux. Elle n’a pas eu lieu.
À peine des escarmouches. Et que dire des « batailles » autour des banques renflouées, du crédit privatisé, du libre-échange intouché ? Ont-elles eu lieu, vraiment ? C’est que nos idées n’étaient pas mûres, ou inadaptées au terrain, ou mal diffusées dans le pays, et que les forces sociales ont manqué pour les porter.
D’autres Doux se produiront.
La crise nous promet encore des soubresauts. Soyons prêts, cette fois, prêts à nous glisser dans la fenêtre d’opportunité que nous ouvrira l’histoire. Voire à en forcer l’ouverture...
– Il veut rigoler ! On est là pour la paye…
– C’est la chaîne. »
Le moment est mal choisi, c’est vrai, pour les questions existentielles : on piétine à l’entrée de l’usine Doux, à Graincourt, dans le Pas-de-Calais. Clopes au bec, moustaches inquiètes, sacs à main en bandoulière, ouvrières et ouvriers sont rassemblés sur le parking, par petits groupes, en ce matin de juillet. Ils débraient depuis l’aube, espèrent encore. Conservent des lambeaux de foi. Qu’il y aurait des projets de reprise, que « là-haut ils vont sortir un lapin blanc de leur chapeau ».
En visite sur le site, d’ailleurs, l’administrateur judiciaire leur a confirmé qu’ « il y aurait, éventuellement, deux acheteurs potentiels », et malgré le conditionnel, et le « éventuellement », et le « potentiels », eux veulent y croire. Malgré les déceptions passées, aussi : « Ils nous ont menti sur un Hollandais, qui devait venir, qui pouvait racheter, mais on l’a jamais vu. Comme ça, on se tient sage. On travaille bien jusqu’au bout. On remplit les commandes. » Et à eux que l’angoisse tenaille, je jette mon interrogation bourgeoise : « Mais est-ce que vous êtes heureux, ici ? » Après la surprise, les remarques fusent, en vrac, de Philippe, Sylvie, Virginie, Jean-Luc, je peine à noter les prénoms au vol, et encore davantage leurs observations sur les salaires, la sécurité, la formation, les souffrances, etc. Je vais classer ça dans l’ordre, maintenant, qu’on entrouvre la porte de ce paradis.
Les clopinettes
« On enlève la prime de froid, on est au Smic. Je ne me rappelle plus avoir eu une augmentation depuis 25 ou 30 ans. » « Avec mon mari, on a un deuxième boulot à côté : on passe tout l’été à faire du gardiennage à Paris. Ça fait cinq ans qu’on n’a pas pris de vacances. Ma fille, je ne la vois plus, je la croise. » « On a acheté une maison il y a deux ans, on en a encore pour 23 ans à la rembourser. On voulait aller au Crédit immobilier de France, mais ils ont refusé : “Nous, on ne prête pas pour les employés de chez Doux. Vous n’êtes pas payés, et le groupe n’est pas solide.” »
« Un directeur, je lui ai dit : “Toi, tu fais tes courses où ?
- À Auchan.
-Moi, à Aldi.” »
Les souffrances
« Ici, ils ne voient que le rendement. À la découpe, on tournait à 2 700 poulets à l’heure, on est passés à 3 200. Ça use. Ça fait des tendinites. Les femmes, la tête baissée, souffrent des cervicales. » « Avec mes cartons de 15 kilos, j’ai calculé : je porte deux tonnes par jour. Depuis quinze ans. Forcément, le dos morfle. » « Après 23 ans ici, ils se sont aperçus qu’on était à 90 décibels. On a perdu des dixièmes au niveau des oreilles, des yeux. » « Ils me font faire un boulot très dur, malgré ma sciatique. Mais on hésite à se mettre en arrêt-maladie, à cause des jours de carence : on est déjà à découvert. »
L’irrespect
« On tourne au ralenti. Du coup, les bêtes abattues vendredi, on ne les a découpées qu’hier, mercredi. Les escalopes avaient une drôle d’odeur. J’ai appelé le chef : “C’est ta bouche, il m’a répondu, elle est trop près de ton nez.” Alors qu’avec cette puanteur, j’étais au bord de dégueuler. »
----------

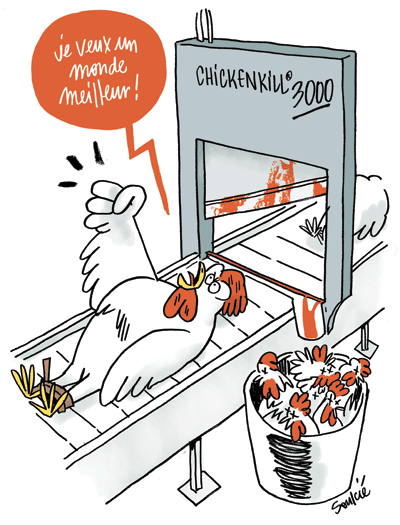

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire